Entretien avec Hajar Ouahbi : « Nous sommes exclus du patrimoine national, mais travaillons ensemble pour nous inclure pleinement dans cet héritage. »

Crédit photo : @xavley
I 14.12.22 I LAÏLANI
ENTRETIEN – Le 9 juillet 2022 se tenait à la Maison de la Conversation, dans le 18ème arrondissement de Paris, la première édition du festival ARTSCHIVES (@arts_chives). Cet évènement annuel célèbre les différentes formes d’expressions et les productions culturelles des diasporas et de leurs descendant·e·s. Le but de ces rencontres, ouvertes au public, est d’engager une discussion autour du patrimoine français et de la place des diasporas dans celui-ci. Nous avons eu l’opportunité de discuter avec la fondatrice du projet, Hajar Ouahbi (@hanuithajour), et de revenir sur ce qui l’a poussée à lancer cette initiative.
Bissai : Bonjour Hajar, pourrais-tu te présenter ?
Hajar : Je m’appelle Hajar, j’ai 22 ans et je suis d’origine marocaine. Je suis née en Italie mais ma famille a déménagé à Nantes il y a 10 ans. Après ça, j’ai étudié à Paris. Je suis actuellement étudiante en Études Culturelles et en Journalisme à NYU (New York University).
Bissai : Que penses-tu de la représentation des Nord-Africain·e·s en France, notamment dans la pop culture (cinéma, séries TV…) ?
Hajar : On peut constater une petite révolution à ce niveau-là, notamment grâce à la démocratisation des moyens de production de contenus. Je dirais que la représentation actuelle des Nord-Africain·e·s à l’écran me convient, sans pour autant transcender mon imaginaire. Si je devais revenir sur le passé, je dirais qu’on était dépeint·e·s de manière assez décevante et essentialiste. On n’avait peu de figures ou de personnages auxquels on pouvait réellement s’identifier. En France, les débuts du cinéma nord-africain s’orientaient beaucoup vers la comédie mais je trouve que ça réduisait considérablement la caisse de résonance de nos récits. Désormais, on fait davantage la part belle au genre dramatique. J’estime que ce phénomène va s’essouffler et qu’il faudra exploiter de nouveaux genres dans le futur. Un point positif : les femmes nord-africaines prennent davantage la parole à travers la création artistique maintenant. Je pense par exemple à La Meute (2022), un court métrage indépendant antiraciste et féministe réalisé par Anaïs Thoa Jullien, Hinde Oueriemmi et Emma Fulcons.
Bissai : D’après toi, quelles sont les conséquences de la sous-représentation des voix des personnes d’origine nord-africaine en France ?
Hajar : Souvent, quand les premiers concernés répondent à cette question, ils évoquent le point de vue des personnes blanches et s’imaginent ce qu’elles peuvent penser de nous face aux représentations qui sont faites de nos communautés au cinéma, à la télévision, dans les médias… Je pense qu’il y a une autre dimension à tout ça : on n’est pas suffisamment au fait de la pluralité des profils au sein de nos propres communautés. Je prêche pour ma paroisse, dans le sens où, quand j’ai quitté Nantes pour Paris, je me suis rendu compte que les récits sur les personnes nord-africaines vivant en banlieue étaient nombreux. Celles qui vivent en province sont bien moins visibles. Elles sont très peu, voire pas du tout, mis en avant dans la sphère publique. Le même problème se pose pour les personnes métisses d’héritage nord-africain. Les expériences de celles et ceux qui ne correspondent pas à l’archétype des Nord-Africain·e·s sont peu valorisées.
« Mon père me répétait souvent : « Dès que tu passes le palier de la porte, tu parles darija et tu es Marocaine. Quand tu sors, tu peux être qui tu veux. Je ne t’impose rien. » »
Hajar Ouahbi

Crédit photo : Leila Cab, Casablanca 2022
Bissai : Quel rapport entretiens-tu avec le Maroc et la langue arabe ?
Hajar : Quand j’étais plus jeune et qu’on retournait au Maroc avec ma famille pour les vacances, j’étais obligée de parler darija (l’arabe dialectal marocain). À l’époque, je ne parlais pas français et l’italien n’est pas une langue répandue au Maroc. Alors qu’aujourd’hui, je peux parler français à ma famille au bled. Je n’ai même plus besoin d’utiliser le darija. Mes parents comprennent le français et l’italien mais c’est important pour eux qu’on parle darija à la maison. Mon père me répétait souvent : « Dès que tu passes le palier de la porte, tu parles darija et tu es Marocaine. Quand tu sors, tu peux être qui tu veux. Je ne t’impose rien. » Il sait pertinemment que le monde peut être dur et qu’il faut savoir s’adapter aux codes. Je trouve ça cool d’avoir des parents qui ont compris que le fait d’avoir grandi en Europe a fait de moi une Marocaine d’un genre un peu différent du leur. Ça nous permet d’avoir un dialogue plus pacifié sur certaines choses.
Ça doit faire 8 ans que je ne suis pas retournée au Maroc. Ça me rend triste mais je n’arrive pas du tout à maintenir le lien avec ma famille restée là-bas car je trouve que nos quotidiens sont assez différents. Ce qui est important pour moi, c’est avant tout de savoir qu’ils sont en bonne santé.
Bissai : Au printemps 2022, tu as organisé un festival pluridisciplinaire qui célèbre les productions culturelles des diasporas, appelé ARTSCHIVES. Comment est né le projet ?
Hajar : L’idée a germé dans ma tête en 2017, j’étais en classe préparatoire (khâgne) à l’époque. J’ai beaucoup pris sur moi en première année. J’étais jeune, la première de ma famille à faire des études supérieures. Je me mettais énormément la pression… En deuxième année, je commençais à être un peu plus à l’aise et à me permettre d’inclure mes propres références culturelles dans mes copies. Je ne me retrouvais pas dans la philosophie continentale qu’on étudiait en classe donc j’aimais citer des penseurs arabes pour ouvrir davantage la réflexion… Sauf que mon professeur ne comprenait pas ma démarche.
Un jour, alors que je corrigeais une de mes copies tout en écoutant de la musique, je suis tombée sur un rappeur : Loyle Carner. J’ai découvert la façon dont il mêlait ses identités guyanienne (du Guyana, pays sud-américain anglophone) et britannique dans son art. Un vrai déclic. Je me suis dit que ça serait bien de permettre à toutes sortes de personnes ayant un profil binational ou plurinational de pouvoir se réunir pour discuter de leur travail afin de montrer que chacun peut apporter quelque chose au « savoir collectif ». Ce « savoir collectif » s’est progressivement transformé en « patrimoine national » parce que le milieu culturel impacte forcément le patrimoine national.
ARTSCHIVES est né de là. J’imaginais le projet comme une discussion libérée mêlant art, musique et politique. La nécessité de donner à l’évènement une dimension pluridisciplinaire était une évidence pour moi étant donné la variété des moyens d’expression existants : photographie, cinéma, mode… Je voyais des ponts entre les disciplines et les identités. C’est pourquoi on met un point d’honneur à parler de diasporas, et non pas uniquement de personnes nord-africaines.
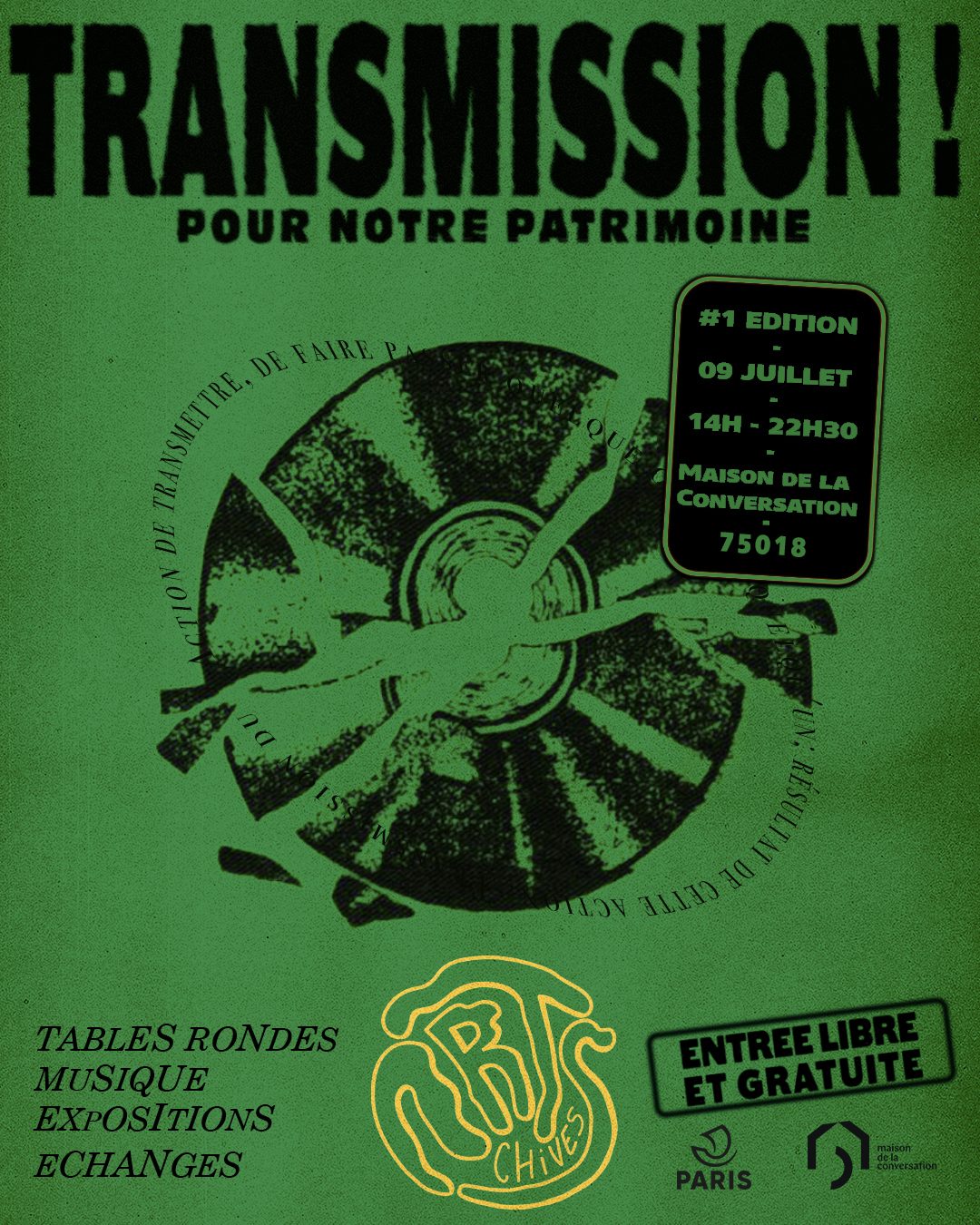
Visuel par @spacey.si
Bissai : Un évènement ARTSCHIVES, ça ressemble à quoi ?
Hajar : Pour l’instant, ça s’organise sur une journée mais on aimerait bien étendre ça sur deux jours. L’an dernier, la thématique était la transmission. Avec l’équipe, on a réalisé qu’on était nombreux et nombreuses à la penser mais à ne pas l’avoir vécue au sein de nos familles respectives. Ça nous a menés à la première table ronde du festival, qui s’intitulait « Transmettre nos silences ». C’était hyper intéressant parce qu’on a parlé de généalogie, de biologie, de ce qui nous a été transmis physiquement, jusque dans notre chair (l’épigénétique). On avait invité Lucas et Gabriel Tétry-Rivière, des frères réunionnais qui ont réalisé le documentaire Nous avons des cendres pour offrandes.
Gurleen, une étudiante en cinéma originaire de la région du Punjab en Inde, est également intervenue pendant le festival pour évoquer l’histoire de sa famille à travers les récits de son grand-père, qui a vécu la Partition de l’Inde et du Pakistan en 1947. Ensuite, on s’est penchés sur la transmission par l’objet. On a écouté La K7 de yaye Elisa, un documentaire audio enregistré par Émilie Mendy, journaliste et auteure de podcasts. C’était très émouvant, d’autant plus que sa mère était présente le jour de l’évènement.
La gastronomie est un autre sujet crucial pour moi. On a eu l’occasion de discuter avec Clarence Kopogo, une cheffe renommée d’origine centrafricaine. Elle a transformé la vision qu’on pouvait avoir des cuisines africaines dans les milieux ultra-élitistes et montré que cet art avait toute sa place dans le patrimoine français. On a accueilli Hicham Touili-Idrissi, un artiste et chercheur travaillant sur la transmission culturelle par la photographie et la cuisine.
Une projection du documentaire Un figuier au pied du terril, réalisé par Mehmet Arikan, Nadia Bouferkas et Naïm Haddad (2017), a également été organisée. Enfin, deux créatrices sont venues exposer leur travail : Esther, la fondatrice de wä dé store, un projet mettant en lumière des artisans et créatifs africains, ainsi que Lucenda Libretto, étudiante à l’Institut Français de la Mode à Paris.
Bissai : De quelle manière utilises-tu ARTSCHIVES comme un instrument politique ?
Hajar : Je pense que la question du patrimoine et de notre place dans celui-ci est foncièrement politique parce qu’elle rappelle à la France son passé colonial. Aujourd’hui, les études post-coloniales sont rendues difficilement possibles dans l’enseignement supérieur français. On ne peut donc pas étudier librement l’État colonial qu’a été la France. À l’école, les livres nous racontent la grande Histoire de la République mais réduisent souvent l’impact de l’esclavage sur l’économie française… Sauf que le pays ne peut pas se défaire de son passé colonial. Il ne peut pas non plus empêcher celles et ceux qui veulent créer de le faire, et d’être bons dans leur domaine. Je pense notamment à Zineb Sedira, une artiste franco-algérienne qui a été choisie pour représenter la France à la 59ème Biennale de Venise en 2022. Cette décision en a choqué plus d’un mais ce qu’elle prouve bien, c’est que la France n’est pas monolithique.
Je vois ARTSCHIVES comme un instrument politique parce que présenter des artistes issus des diasporas ainsi que leur travail sous le spectre du patrimoine national, c’est questionner notre place au sein de la société. Zineb Sedira n’incarne pas seulement une partie de l’histoire de la France, mais l’Histoire de la France à part entière. L’indépendance de l’Algérie, c’était dans les années 60 donc il n’y a pas si longtemps que ça…
« Je ne me sens toujours pas légitime mais parfois, il faut éviter de se poser trop de questions et se lancer,
tout simplement. »
Hajar Ouahbi
Bissai : Quelle est ton ambition sur le long terme avec cette initiative ?
Hajar : Pour l’instant, on se concentre sur l’organisation d’évènements avec des artistes locaux, peut-être même avec des habitants des villes concernées à l’avenir. J’aimerais décloisonner le festival pour en faire un projet itinérant qui passerait par Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, mais aussi Nantes, ma ville d’origine… Ensuite, à très long terme, j’aimerais qu’on puisse intervenir à travers toute l’Europe. J’ai pu constater que de nombreuses diasporas se mobilisaient à l’étranger : aux Pays-Bas, en Angleterre, en Belgique…
Bissai : Quel était ton rapport à l’art avant la création d’ARTSCHIVES ? Dans quel état d’esprit étais-tu en te lançant dans cette aventure ?
Hajar : J’ai eu l’idée d’ARTSCHIVES en 2017 mais la première édition n’a eu lieu qu’en 2022. Pendant ces cinq années, j’ai assisté à beaucoup d’évènements culturels. Je prenais des notes, je réseautais… C’était important pour moi de prendre du recul avant d’entreprendre quoi que ce soit pour déterminer ma plus-value. Je ne me sens toujours pas légitime mais parfois, il faut éviter de se poser trop de questions et se lancer, tout simplement. En fait, on en revient à la question de la représentation. Voir des jeunes comme moi entreprendre des choses, s’engager sur la route de l’art et réussir, ça a provoqué en moi des réflexions que je n’aurais jamais eues toute seule, et ça m’a inspirée.

Visuel par @spacey.si
Bissai : De qui est constituée la communauté ARTSCHIVES ?
Hajar : Elle regroupe des personnes jeunes et d’autres un peu moins jeunes, toutes plutôt insérées dans la vie active. En général, elles sont impliquées dans les milieux de la culture, de l’art, et/ou des sciences humaines et sociales. Elles se posent des questions sur la façon dont on peut se réapproprier notre place dans l’espace public, en tant que membres de différentes diasporas. J’aimerais aussi qu’on puisse toucher des gens qui sont impliqués dans le milieu associatif. C’est pourquoi on va opter pour du street marketing pour la 2ème édition d’ARTSCHIVES, qui aura lieu en juin 2023. On compte aller à la rencontre de structures qui s’impliquent sur le territoire où l’on organise notre évènement (le 18ème arrondissement) : des associations de quartier, des centres sociaux… Des tas de gens ont bâti des choses avant moi et je tiens à les mettre en valeur. J’ai envie d’être le plus inclusive possible et de démocratiser les savoirs liés à l’expérience des diasporas pour que la communauté d’ARTSCHIVES accueille des gens « ordinaires », comme toi et moi.
Bissai : Le mot de la fin ?
Hajar : Je cite systématiquement Stuart Hall. Ses mots apparaissent dans le manifeste d’ARTSCHIVES : « Ceux qui ne se reconnaissent pas dans le patrimoine national en sont exclus ». Cette citation a été révolutionnaire pour moi et m’a permis de résoudre un tas de choses à titre personnel. Même si la fin peut paraître abrupte, je dirais qu’elle ne constitue pas une fatalité. Nous sommes exclus du patrimoine national, certes, mais travaillons à présent ensemble pour nous inclure pleinement dans cet héritage.
Les reco de Hajar Ouahbi

La série Atlanta : je conseille particulièrement de voir l’épisode 6 de la saison 3, intitulé « White fashion » (2022). Il traite notamment de la façon dont, aux États-Unis, les grandes entreprises utilisent des célébrités noires pour « combattre » leur propre racisme et en tirer profit.

Caroline Randall Williams (auteure, poétesse et universitaire américaine) : elle a écrit un essai puissant qui est paru dans le New York Times en juin 2020. Intitulé « You want a confederate monument ? My body is a confederate monument », il évoque la mesure dans laquelle son corps, son métissage et son existence même sont une preuve du passé esclavagiste des États-Unis.
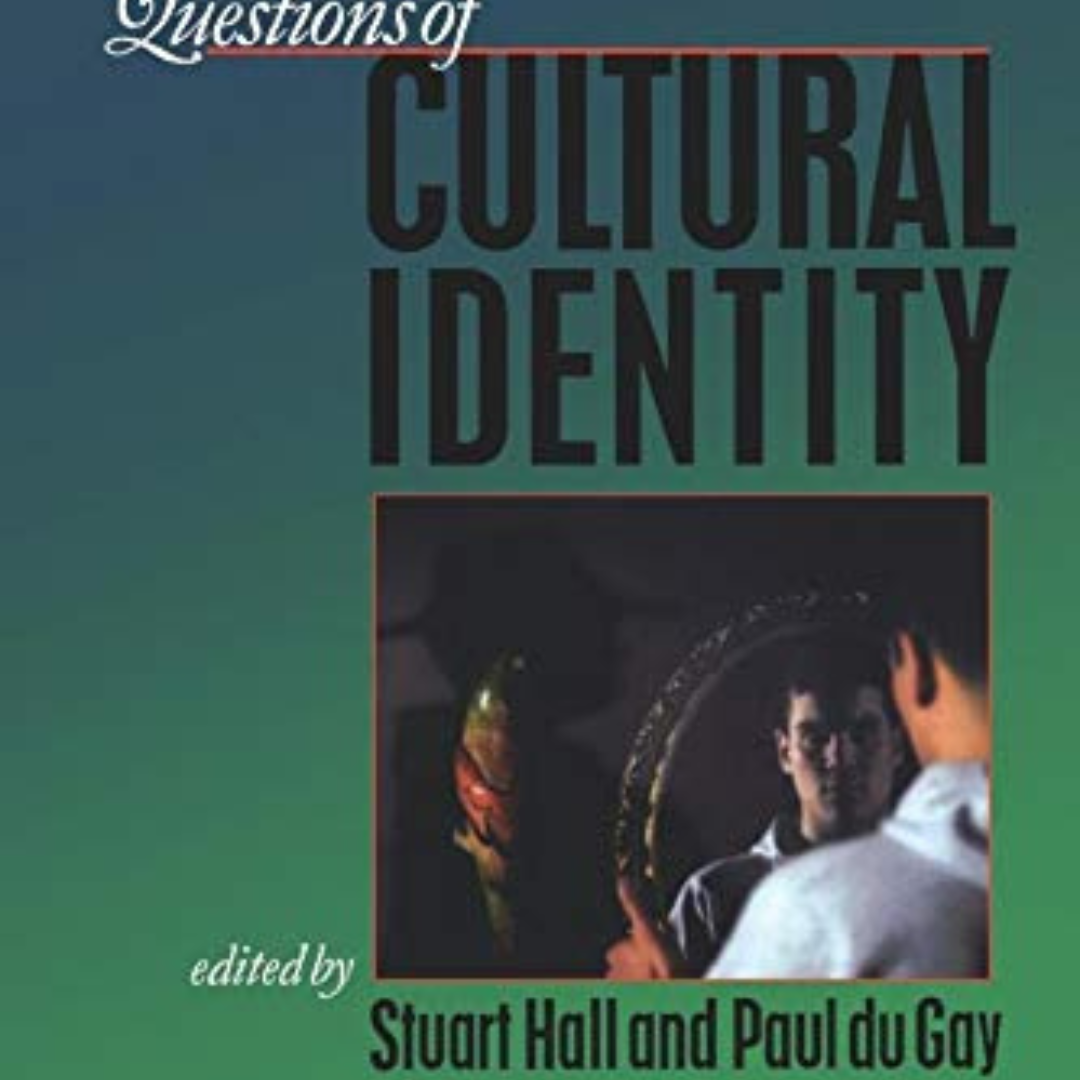
Questions of Cultural Identity, de Stuart Hall et Paul du Gay (1996) : le sociologue Stuart Hall fait partie des grandes figures des Études Culturelles britanniques. Paul du Gay est professeur à Copenhagen Business School (Danemark). Leur livre décortique les raisons pour lesquelles la question de l’identité est à la fois si passionnante et si complexe.
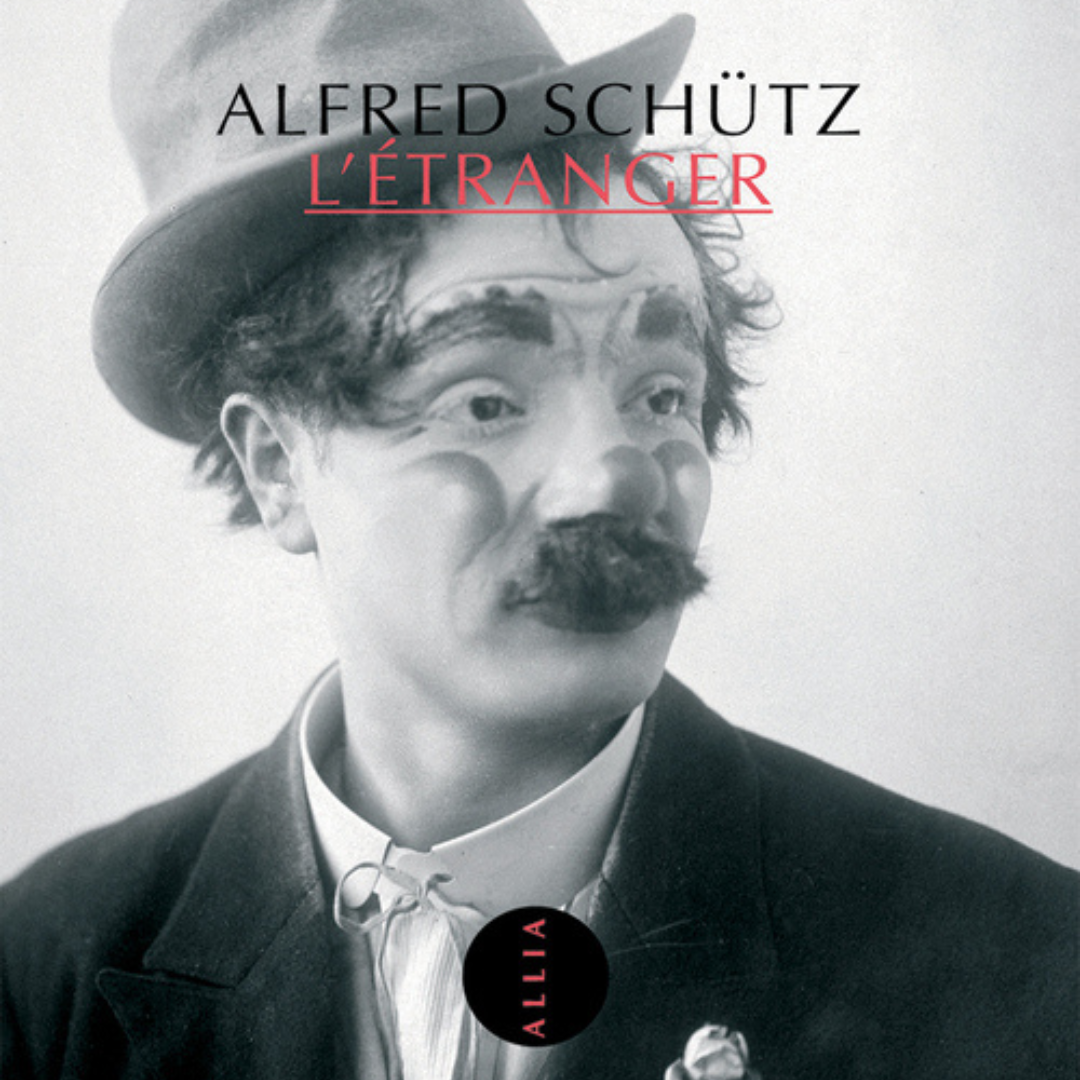
L’étranger, d’Alfred Schütz (2003) : il s’agit d’un essai de psychologie sociale au croisement de la sociologie, de la philosophie et de l’anthropologie. L’auteur y analyse les difficultés éprouvées par celui ou celle qui quitte son groupe d’origine pour s’intégrer dans un nouvel ensemble social.
Le 15/12/2022 – Propos recueillis par Laïlani Ridjali




